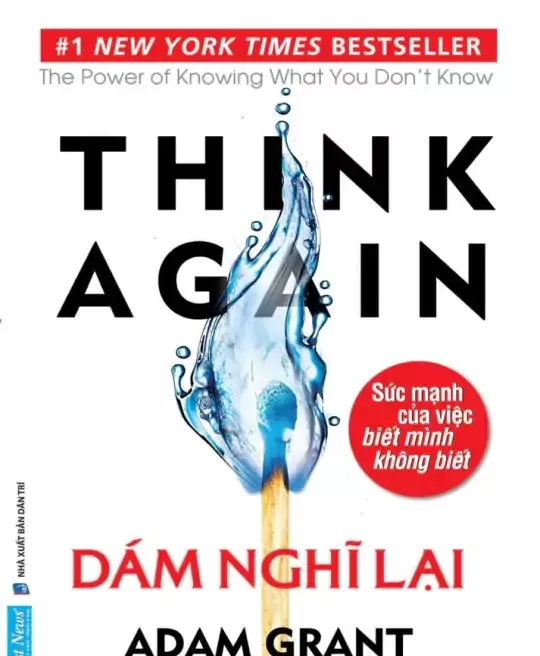monotones. « Il est temps que cela finisse », disaient nos concitoyens, parce
qu’en période de fléau, il est normal de souhaiter la fin des souffrances
collectives, et parce qu’en fait, ils souhaitaient que cela finît. Mais tout cela
se disait sans la flamme ou l’aigre sentiment du début, et seulement avec les
quelques raisons qui nous restaient encore claires, et qui étaient pauvres. Au
grand élan farouche des premières semaines avait succédé un abattement
qu’on aurait eu tort de prendre pour de la résignation, mais qui n’en était
pas moins une sorte de consentement provisoire.
Nos concitoyens s’étaient mis au pas, ils s’étaient adaptés, comme on
dit, parce qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement. Ils avaient encore,
naturellement, l’attitude du malheur et de la souffrance, mais ils n’en
ressentaient plus la pointe. Du reste, le docteur Rieux, par exemple,
considérait que c’était cela le malheur, justement, et que l’habitude du
désespoir est pire que le désespoir lui-même. Auparavant, les séparés
n’étaient pas réellement malheureux, il y avait dans leur souffrance une
illumination qui venait de s’éteindre. À présent, on les voyait au coin des
rues, dans les cafés ou chez leurs amis, placides et distraits, et l’œil si
ennuyé que, grâce à eux, toute la ville ressemblait à une salle d’attente.
Pour ceux qui avaient un métier, ils le faisaient à l’allure même de la peste,
méticuleusement et sans éclat. Tout le monde était modeste. Pour la
première fois, les séparés n’avaient pas de répugnance à parler de l’absent,
à prendre le langage de tous, à examiner leur séparation sous le même angle
que les statistiques de l’épidémie. Alors que, jusque-là, ils avaient soustrait
farouchement leur souffrance au malheur collectif, ils acceptaient
maintenant la confusion. Sans mémoire et sans espoir, ils s’installaient dans
le présent. À la vérité, tout leur devenait présent. Il faut bien le dire, la peste
avait enlevé à tous le pouvoir de l’amour et même de l’amitié. Car l’amour
demande un peu d’avenir, et il n’y avait plus pour nous que des instants.
Bien entendu, rien de tout cela n’était absolu. Car s’il est vrai que tous
les séparés en vinrent à cet état, il est juste d’ajouter qu’ils n’y arrivèrent
pas tous en même temps et qu’aussi bien, une fois installés dans cette